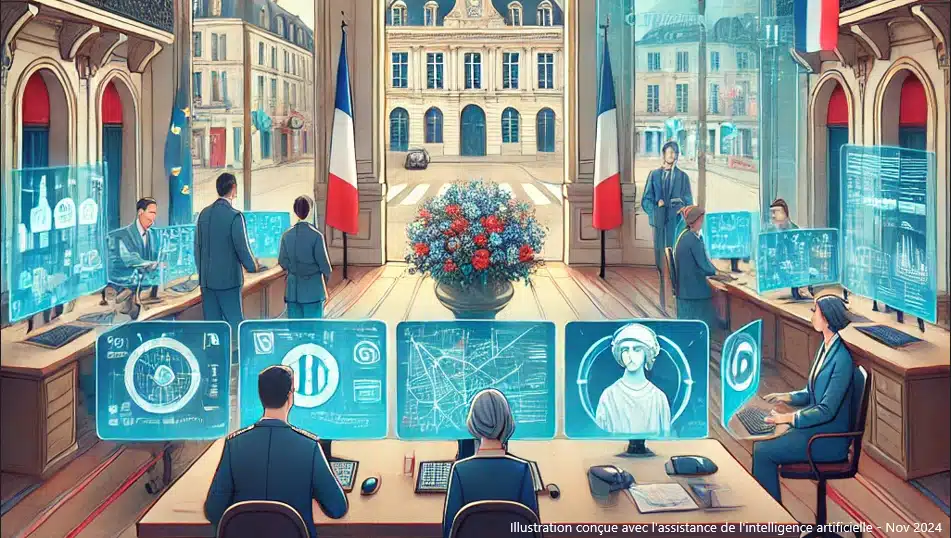Auxilia concentre le plus clair de ses recherches et de son action dans le champ de la mobilité sur la compréhension de la dépendance à la voiture et sur les vulnérabilités qu’elle entraine pour les territoires et les publics les plus contraints. Nous n’allons donc pas nous émouvoir que le sujet gagne en visibilité. En revanche, ce qui apparaît très problématique est la confusion générée par l’utilisation d’une série d’acceptions erronées du terme « dépendance », souvent à dessein et pour attaquer toute remise en cause de celle-ci. Ne pourrions-nous pas nous essayer à l’introduction d’une autre notion dans la qualification du rapport à la voiture : celle d’addiction ? Et ainsi tenter à la fois d’apporter un peu de nuance et d’explorer les pistes de réflexion que cette légère bascule sémantique peut nous suggérer…
Clarifions les termes du débat pour œuvrer plus efficacement à la réduction des vulnérabilités engendrées par la dépendance à la voiture et pour la transition écologique des mobilités. Laurent Jégou.
La dépendance à la voiture, au sens strict d’absence d’autonomie pour accomplir les tâches de la vie quotidienne, est une réalité pour un très grand nombre de Français.e.s ; source de renoncements divers, d’éloignement de l’emploi et de dépenses contraintes exacerbées. Ici, le terme de dépendance n’est bien sûr en rien galvaudé et il renvoie clairement à un mécanisme très pratique de sujétion.
La notion d’addiction, au sens du maintien d’un usage en dépit de la conscience du caractère nuisible de celui-ci, et qui renvoie à des mécanismes d’ordre psychologique, semble en revanche plus appropriée pour qualifier un large pan du rapport qu’entretiennent les individus à la voiture. Au-delà des études statistiques qui nous rappellent régulièrement qu’aucune fatalité ne lie la majorité de nos déplacements à l’automobilisme, c’est ce qui ressort de manière très forte de nos échanges constants avec les citoyens dans nos missions : la voiture est omniprésente dans nos vies, dans nos villes, dans nos budgets, malgré les nuisances évidentes qu’elle génère et alors que l’on pourrait en réduire sensiblement l’usage et la possession. Ce rapport addictif s’exprime d’ailleurs de manière individuelle comme collective et politique, quand notre société semble piégée dans une incapacité à penser un cadre de vie affranchi de l’omniprésence de la voiture.
L’origine comme les mécanismes de maintien dans cette situation d’addiction sont de mieux en mieux connus : héritage d’un demi-siècle de mythification de l’objet voiture (longtemps, à juste titre, porteur d’imaginaires d’émancipation et de liberté), consciencieusement entretenu par un matraquage publicitaire qui nous rappelle que, sans une imposante voiture, point de statut social ni de liberté. Notre addiction collective à la voiture semble d’ailleurs renvoyer directement à l’addiction plus globale de la société à l’accès à tout, à la jouissance facile et immédiate : c’est tout notre rapport au temps et à l’accessibilité, construit grâce et autour de la voiture, qui fonde notre relation actuelle à elle. Ainsi, le sentiment de dépossession qui nous submerge dès qu’on envisage la remise en cause de son primat est de la même nature que celui qui parcourt actuellement notre société découvrant la finitude des ressources planétaires et le nécessaire abandon de nombreux « plaisirs » : le vertige du manque.
Poussons la logique et voyons maintenant si certaines approches suivies dans le traitement des addictions peuvent nous suggérer quelques pistes de réflexion pour des actions en faveur d’une moindre place de la voiture dans nos vies.
A l’échelle individuelle, le principe de « traitement substitutif », qui permet aux personnes sujettes à des addictions de type drogues ou alcool de s’engager dans une démarche de sortie sans subir d’effets de manque et en limitant les conséquences sur leur vie, est par exemple éclairant. Dans le cas de la voiture, le sevrage trop violent vis-à-vis de l’efficacité, la flexibilité et l’autonomie offertes par celle-ci a, de la même manière, peu de chance d’aboutir et on doit lui préférer des solutions alternatives convaincantes pour les usages ciblés. On peut penser en particulier aux solutions telles que le vélo ou l’autopartage qui, si les conditions pour une pratique réellement satisfaisante sont créées, permettront des changements de comportement vis-à-vis de la voiture plus profonds et socialement mieux acceptés que les restrictions brutales. Quand elle n’est pas indispensable, la voiture reste tellement « efficace » dans le système de mobilité de nos sociétés qu’il est impensable de chercher à s’en passer totalement, mais on doit créer les conditions pour que l’immense vivier de report modal vers ses substituts soit pleinement exploité.
Ne pas rompre violemment avec ses pratiques, mais accepter d’engager de nécessaires renoncements… De la même manière que les personnes en traitement sont accompagnées dans une démarche de construction d’une identité sans la consommation nocive et d’une réinvention du rapport à la jouissance (principe de « post-cure »), le détachement vis-à-vis de la voiture doit passer par une réinvention de son rapport à la consommation de l’espace et du temps, qui se traduit par la substitution de nouveaux plaisirs à d’anciens, qui étaient conditionnés à une « hypermobilité ».
Notons, d’ailleurs, que le parallèle avec le champ de l’addiction s’avère particulièrement pertinent sur la question de l’accompagnement : la sortie d’une dépendance psychologique et organisationnelle à la voiture s’accompagne, tout comme celle d’une dépendance à une consommation de produits nuisibles ! Certains principes thérapeutiques, comme l’entretien motivationnel, ne sont d’ailleurs pas sans rappeler des outils que nous mobilisons dans nos missions d’accompagnement du changement de pratiques de mobilité.
A l’échelle collective, enfin, de nombreuses pistes peuvent également nous être suggérées par le passage du champ de la seule dépendance pratique vers celui de l’addiction. A commencer par reconnaître le rôle très puissant joué par la publicité dans le maintien de la population dans ce rapport addictif à la voiture, à travers les imaginaires de liberté, d’affirmation et de puissance ; et alors se poser enfin plus sérieusement la question de la régulation de celle-ci. Considérer l’automobiliste comme sujet à une addiction peut également permettre d’imaginer des discours mieux calibrés et plus susceptibles de remporter l’adhésion du grand public : moins culpabilisants, sollicitant davantage la reconnaissance des déterminants de notre attachement à la voiture (et notamment ses aspects positifs) pour imaginer des récits collectifs fédérateurs et, réellement, émancipateurs.
Au lieu de poursuivre une fuite en avant sur la voiture faite d’électrification irréfléchie et de fantasmes d’autonomisation, acceptons la difficulté du sevrage et mettons les moyens pour construire collectivement notre sobriété !
* Un grand merci à mon ami et psychiatre Hiroshi pour son éclairage sur les approches d’accompagnement des addictions